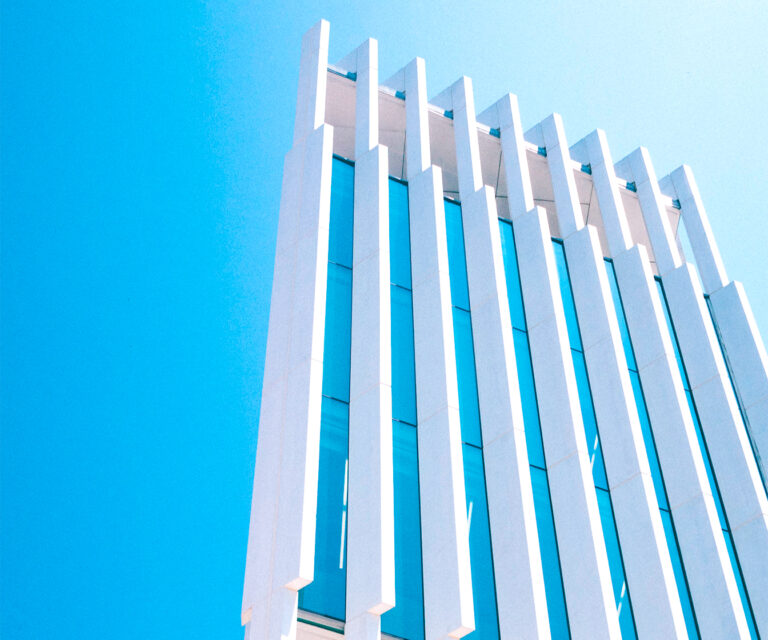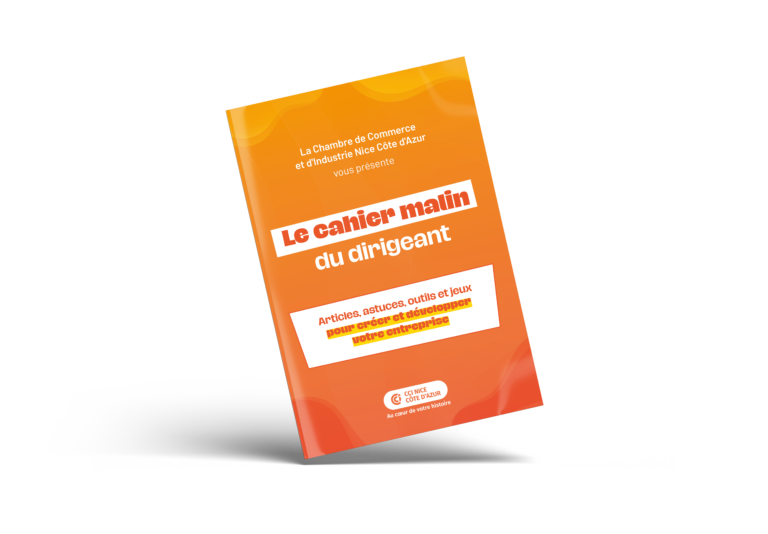Dans un contexte marqué par le dérèglement climatique, l’étude « Croissance bleue 06 » propose une vision de la filière maritime fondée sur la durabilité, l’innovation et la résilience. L’étude offre aux acteurs publics et privés un cadre stratégique pour accompagner la transition écologique du secteur et renforcer l’attractivité du territoire.
Périmètre de l’économie bleue dans les Alpes-Maritimes
Dans les Alpes-Maritimes, ces activités sont regroupées en 8 segments distincts : ressources marines biologiques, yachting et plaisance, transport maritime, construction et réparation navale, activités portuaires, plages, sports et loisirs en mer, ressources marines non biologiques et Blue tech et R&D.
État des lieux : une filière stratégique, dynamique mais vulnérable
Avec 146,5 km de façade maritime, 37 ports, et une forte spécialisation dans le tourisme côtier, la navigation de plaisance et le yachting, les Alpes-Maritimes s’imposent comme un territoire maritime d’envergure. En 2024, l’économie bleue représentait 1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires, portée par un tissu économique dense de 2120 établissements et 5 000 emplois, dont 95 % de très petites entreprises (TPE). Sa contribution est comparable à celle de la filière spatiale (1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 5 800 emplois).
Près de deux tiers de l’activité maritime sont liés au nautisme, notamment à travers la location-vente de bateaux et la maintenance-réparation navale. Par ailleurs, on observe une émergence et une consolidation des activités liées à la Blue-tech. Avec une quarantaine d’entreprises clairement identifiées, les activités exercées sont variées : acoustique sous-marine, surveillance de la qualité des eaux, gestion de la pollution marine, productivité, biosécurité des élevages aquacoles, amortissement des vagues de tempête… Une large part d’entre elles vise à réduire les impacts environnementaux de la filière.
Enjeu : une transition écologique devenue impérative face à une vulnérabilité croissante.
L’économie bleue azuréenne, bien que dynamique, est aujourd’hui confrontée à une double pression environnementale. D’une part, les activités maritimes contribuent au dérèglement climatique : pollution de l’air, de l’eau, des sols, et dégradation des écosystèmes marins. D’autre part, ce même dérèglement climatique menace directement la filière : intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, élévation du niveau de la mer, raréfaction des ressources marines, et pression accrue sur les ressources hydriques et énergétiques.
Une interaction circulaire s’installe entre ces deux dimensions tendant à amplifier leurs effets respectifs. Les professionnels doivent désormais composer avec des normes environnementales renforcées, des risques naturels plus fréquents, et une incertitude croissante sur la pérennité de leurs modèles économiques. Cela est de nature à augmenter les coûts d’exploitation des entreprises, avec un risque important de cessation d’activité pour les celles n’ayant pas les ressources nécessaires pour s’adapter.
Face à ces défis, l’étude révèle une prise de conscience croissante au sein de la filière : 63 % des entreprises interrogées sont déjà engagées dans des démarches visant à réduire leur empreinte environnementale. Cette mobilisation se traduit par des actions concrètes telles que la sensibilisation des collaborateurs, l’adaptation des pratiques, ou encore l’investissement dans des technologies plus propres.
Cependant, des freins majeurs subsistent : le coût des investissements nécessaires, la complexité réglementaire, la résistance au changement interne, et l’inertie des pratiques historiques. Ces obstacles ralentissent la transformation du secteur et appellent à un accompagnement renforcé des acteurs économiques pour accélérer la transition.
De la contrainte à l’opportunité : construire une économie bleue plus verte et résiliente
La transition écologique offre l’opportunité aux entreprises locales de conquérir de nouveaux marchés (yachting durable, recyclage et revalorisation des déchets, biotechnologies marines) et de renforcer leur compétitivité.
Il s’agit désormais d’accompagner les acteurs en levant les freins identifiés et de proposer un plan d’action pour répondre aux défis environnementaux et économiques autour de quatre axes stratégiques :
- Le réajustement du cadre réglementaire pour concilier exigences environnementales et performances économiques ;
- Le soutien aux démarches de R&D pour encourager l’innovation bleue ;
- La promotion et la consolidation d’une culture de la mer écoresponsable ;
- Le déploiement d’une stratégie d’attractivité autour de la mer et de la résilience de ses activités.
L’ensemble de ces axes nécessite de développer en transversal :
- les compétences de demain, afin d’adapter les cursus de formation locaux, pour répondre aux nouveaux besoins de l’économie bleue durable.
- des alliances stratégiques avec les territoires voisins, notamment italiens et monégasques, pour faire du bassin méditerranéen nord-occidental un pôle d’excellence européen en matière d’économie bleue durable.
Pour télécharger la synthèse de l’étude :
https://www.cote-azur.cci.fr/app/uploads/2025/11/synthese-etude-croissance-bleue-A4.pdf