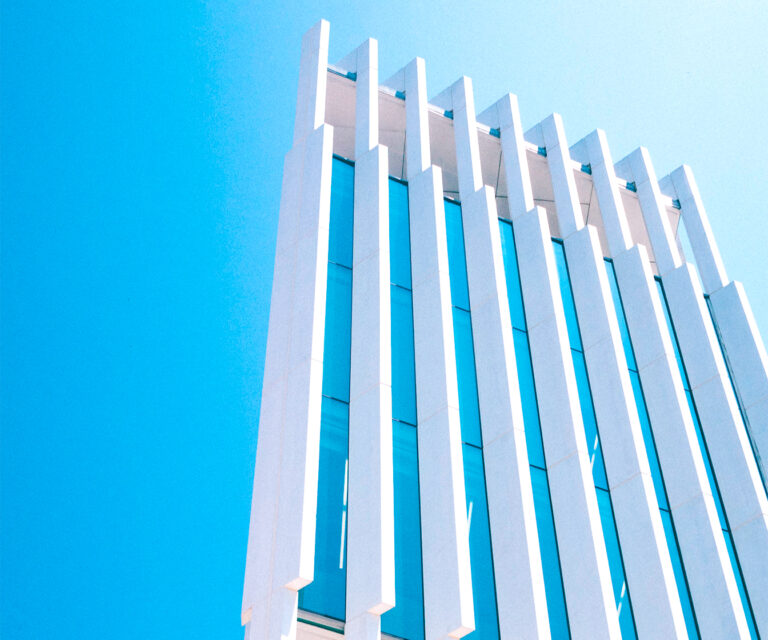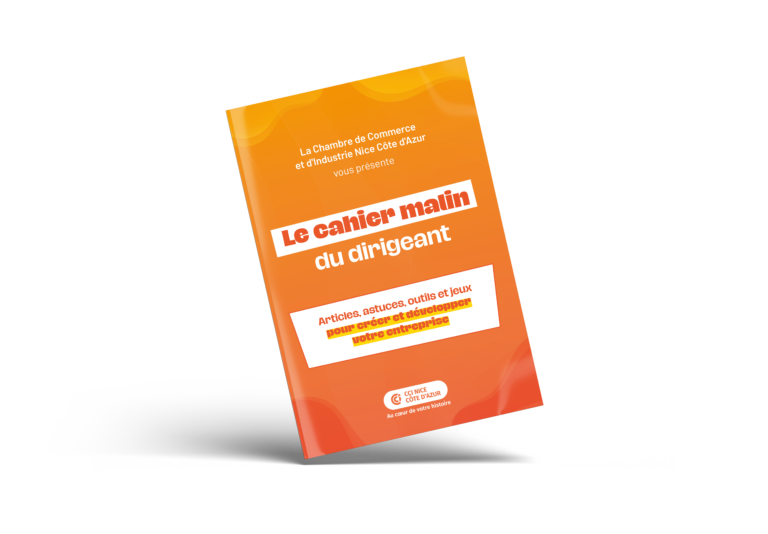Créer son entreprise, c’est avant tout choisir un cadre juridique adapté à ses ambitions et à sa réalité économique.
Parmi les options les plus populaires en France, deux statuts se distinguent par leur accessibilité : la micro-entreprise (anciennement auto-entrepreneur) et l’entreprise individuelle (EI). Derrière cette simplicité apparente, des logiques différentes se dessinent.
Le choix du statut ne dépend pas de la simplicité, mais de la stratégie.
Le récap’ :
| Critères | Auto-entrepreneur (micro-entreprise) | Entreprise individuelle (EI) |
| Chiffre d’affaires maximum | Oui : 188 700 € (vente) / 77 700 € (service) | Non |
| Régime fiscal | Micro-fiscal simplifié (option pour versement libératoire) | Réel simplifié ou normal |
| Comptabilité | Allégée | Complète, obligations accrues |
| Charges sociales | Calculées sur le chiffre d’affaires | Calculées sur le bénéfice (BIC/BNC) |
| TVA | Franchise en base (possible) | Collectée et déductible selon régime |
| Déduction des frais professionnels | Non (abattement forfaitaire uniquement) | Oui, frais réels déductibles |
| Souplesse administrative | Très élevée | Moins souple, obligations plus lourdes |
Comprendre la différence entre auto-entrepreneur et entreprise individuelle
Deux statuts en apparence proches… mais avec des différences clés
Il est essentiel de comprendre qu’il ne s’agit pas de deux statuts juridiques différents. Le terme “auto-entrepreneur”, aujourd’hui remplacé par “micro-entrepreneur”, désigne en réalité un régime fiscal et social rattaché à l’entreprise individuelle. Autrement dit, toutes les micro-entreprises sont juridiquement des entreprises individuelles, mais toutes les entreprises individuelles ne relèvent pas du régime micro.
La micro-entreprise a été conçue pour répondre aux besoins des créateurs d’activité en quête de simplicité. Pas de comptabilité classique, pas de TVA à collecter dans la majorité des cas, une imposition basée sur le chiffre d’affaires, et non sur le bénéfice. Le régime est volontairement “plug and play”, pour faciliter le test d’une activité ou son exercice à petite échelle.
À l’opposé, l’entreprise individuelle classique permet une approche plus structurée : vous déclarez vos charges réelles, collectez la TVA, et vous pouvez choisir un régime fiscal adapté à votre chiffre d’affaires. Cela nécessite une gestion rigoureuse, mais ouvre la porte à une meilleure maîtrise des résultats nets et à une optimisation fiscale possible.
| 🔎 Bon à savoir :
Depuis la réforme de 2022, la distinction entre les deux s’estompe juridiquement : la micro-entreprise est un régime simplifié de l’EI, et non un statut en soi (source : service-public.fr). |
Les critères de choix
Le plafond de chiffre d’affaires est le premier filtre objectif.
Le seuil de chiffre d’affaires constitue souvent un premier filtre : au-delà de 188 700 € pour les activités commerciales ou 77 700 € pour les prestations de service, le régime micro devient inapplicable.
Autre distinction majeure : la possibilité de déduire les charges réelles. En micro-entreprise, un abattement forfaitaire est appliqué, sans tenir compte des dépenses réelles. À l’inverse, l’EI permet de déduire chaque dépense liée à l’activité (loyer, matériel, déplacements…), ce qui peut fortement réduire le bénéfice imposable.
Quel profil pour quel régime ?
Le micro-entrepreneur est typiquement un indépendant qui se lance seul, avec peu de frais et une volonté de simplicité : graphiste freelance, coach, artisan, consultant en reconversion. Il cherche à tester une activité sans s’alourdir de procédures comptables ou fiscales.
Micro-entrepreneur : le bon cadre pour tester sans trop investir.
Le chef d’entreprise individuelle classique, lui, a souvent une vision plus durable de son activité. Il prévoit d’investir, d’embaucher à terme, ou d’optimiser sa fiscalité. Ce statut est souvent adopté par des professionnels libéraux structurés, des commerçants avec des stocks ou des artisans en croissance.
L’EI classique est pensée pour ceux qui anticipent la croissance.
Les impacts fiscaux et sociaux à ne pas négliger
Fiscalité : impôt sur le revenu ou versement libératoire ?
En régime micro, l’entrepreneur peut opter pour le versement libératoire : l’impôt sur le revenu est payé mensuellement ou trimestriellement, à un taux fixe sur le chiffre d’affaires (1 %, 1,7 %, ou 2,2 % selon l’activité). C’est simple, lisible, et sans surprise, mais potentiellement moins avantageux si les charges sont élevées.
À noter :
- Le versement libératoire est accessible sous conditions de chiffre d’affaires et de revenu fiscal de référence.
- Option à effectuer auprès de l’Urssaf avant le 30 septembre pour application l’année suivante.
L’entreprise individuelle en régime réel permet d’opter pour une imposition sur le bénéfice réel : vous déduisez toutes vos dépenses avant calcul de l’impôt. Cette option offre une optimisation fiscale potentielle, mais au prix d’une comptabilité complète et de déclarations plus complexes.
Cotisations sociales : un coût proportionnel à vos revenus
Le calcul des charges sociales est également structurant. En micro-entreprise, tout repose sur un taux fixe appliqué au chiffre d’affaires, pour 2025, les principaux taux sont :
- 12,3 % pour une activité commerciale (achat/vente).
- 21,2 % pour les prestations de services commerciales ou artisanales (BIC).
- 24,6 % pour les prestations de services libérales non réglementées (BNC).
- 23,2 % pour les professions libérales relevant de la CIPAV.
Pas de chiffre d’affaires = pas de cotisations.
Ici, les cotisations sociales sont calculées sur le résultat net (recettes – charges). Cela implique que même si le chiffre d’affaires est faible, mais les charges déductibles le sont aussi, il peut rester un résultat net sur lequel des cotisations seront exigibles.
Si le chiffre d’affaires est nul (et donc le résultat net aussi), vous ne paierez rien, sauf éventuellement une cotisation minimale pour certaines branches (ex. retraite, dans certains cas particuliers).
Quelles démarches pour créer votre entreprise ?
La création d’une entreprise, qu’elle soit micro ou EI classique, s’effectue désormais via des plateformes centralisées comme guichet-entreprises.fr ou INPI.fr. La procédure est rapide : en quelques clics, vous complétez votre déclaration, choisissez votre régime fiscal, et recevez sous une dizaine de jours un numéro SIRET.
Le coût de création est nul pour une micro-entreprise et reste faible pour une EI classique. Ce qui diffère, c’est le niveau d’information exigé : une EI demande plus de précisions (TVA, régime réel…), ce qui suppose de maîtriser les implications dès le départ.
Focus sur les formalités selon le régime
En micro-entreprise, la déclaration de début d’activité est simplifiée, tout comme les choix fiscaux. L’obtention du SIRET est automatique, et aucune comptabilité spécifique n’est exigée au-delà du suivi du chiffre d’affaires.
En EI classique, les démarches sont un peu plus structurantes : choix du régime fiscal réel, inscription à la TVA au-delà de certains seuils, obligation de tenir une comptabilité complète, etc. Ce cadre plus exigeant est toutefois un préalable nécessaire à la professionnalisation de l’activité.
Se faire accompagner dans son choix : le rôle de la CCI Nice Côte d’Azur
Dans un contexte réglementaire qui évolue rapidement, choisir son statut sans accompagnement peut conduire à des erreurs coûteuses. La CCI Nice Côte d’Azur propose un soutien stratégique aux créateurs d’entreprise. À travers des rendez-vous personnalisés, vous pouvez analyser votre situation, confronter les options et bâtir un choix cohérent avec vos objectifs.
Les conseillers CCI vous aident à anticiper les contraintes fiscales, sociales et comptables, mais aussi à choisir des solutions de financement ou d’assurance adaptées à votre projet.
Pour aller plus loin, la CCI propose une palette d’outils pratiques :
- Des ateliers thématiques pour comparer les statuts et comprendre vos obligations.
- Des diagnostics personnalisés pour aligner votre choix de régime avec votre business plan.
- Un accompagnement aux formalités, avec une aide à la rédaction des déclarations, au choix du régime fiscal et aux premiers pas administratifs.
👉 Créer ou reprendre une entreprise
👉 Formalités de création d’entreprise
Créer seul, c’est possible. Mais bien choisir, ça ne s’improvise pas.
Le récap : les étapes à retenir
✅ Le régime de micro-entrepreneur est accessible, rapide à mettre en œuvre, et parfait pour démarrer une activité à faible coût.
✅L’entreprise individuelle classique permet plus de souplesse fiscale et permet la déduction des frais réels, au prix de contraintes comptables.
✅La fiscalité et les charges sociales sont très différentes entre les deux régimes : à évaluer selon votre chiffre d’affaires prévisionnel.
✅La création d’entreprise est simplifiée grâce aux démarches en ligne, mais mérite d’être accompagnée pour sécuriser les choix initiaux.
✅La CCI Nice Côte d’Azur est un partenaire clé pour les créateurs d’activité souhaitant poser des bases solides.
FAQ : Micro-entreprise ou entreprise individuelle – les questions que vous vous posez (vraiment)
Puis-je passer d’une micro-entreprise à une entreprise individuelle classique sans fermer mon activité ?
Oui, tout à fait. Il ne s’agit pas d’un changement de statut juridique, mais d’un changement de régime fiscal et social. Vous restez en entreprise individuelle, mais vous basculez du régime micro vers le régime réel. Ce changement peut être effectué en début d’année civile et doit être déclaré auprès de l’Urssaf et de l’administration fiscale. Attention, ce choix est souvent irréversible pendant 2 ans, sauf cessation d’activité.
Un auto-entrepreneur peut-il facturer à des entreprises comme une EI classique ?
Absolument. Le type de clients (particuliers, entreprises, collectivités…) n’est pas conditionné par le statut. Ce qui change, ce sont les mentions obligatoires sur les factures, notamment en cas de franchise en base de TVA, ou les seuils de chiffre d’affaires qui peuvent limiter l’activité d’un micro-entrepreneur en B2B très actif.
Que se passe-t-il si je dépasse les seuils de chiffre d’affaires en micro-entreprise ?
En cas de dépassement des plafonds (188 700 € ou 77 700 € selon l’activité), le régime micro reste applicable l’année du dépassement, mais vous basculez automatiquement en régime réel l’année suivante, sauf si le dépassement est répété deux années consécutives. Cela implique de collecter la TVA dès le franchissement de seuils intermédiaires (91 900 € ou 36 800 €). Le passage au réel vous impose une comptabilité complète et un changement du mode d’imposition.
Peut-on cumuler micro-entreprise et activité salariée ?
Oui, et c’est un cas fréquent. Le cumul est autorisé, que vous soyez en CDI, CDD, fonctionnaire (sous certaines conditions), ou en retraite. Il convient néanmoins de vérifier que le contrat de travail ou le statut n’interdit pas cette activité parallèle. À noter : le cumul peut impacter le montant total de vos cotisations sociales ou le calcul de l’impôt global sur le revenu.
Une micro-entreprise peut-elle avoir un local commercial ou des salariés ?
Oui, mais avec des limites à bien comprendre. Posséder un local professionnel ou commercial est possible, mais cela peut augmenter les charges fixes sans possibilité de les déduire (dans le régime micro). Quant à l’embauche de salariés, elle est autorisée, mais impose des formalités supplémentaires (DPAE, bulletin de paie, charges sociales…). La micro-entreprise devient alors moins adaptée : l’EI classique offre plus de latitude dans ce cas.
L’assurance professionnelle est-elle obligatoire dans les deux cas ?
Ce n’est pas le régime juridique qui détermine l’obligation, mais le secteur d’activité. Certaines professions sont légalement tenues de souscrire une RC Pro (ex : BTP, santé, conseil réglementé…). Pour les autres, elle reste vivement recommandée, quel que soit le statut. La responsabilité de l’entrepreneur est toujours engagée, y compris en micro-entreprise.
Le choix du statut a-t-il un impact sur la retraite ?
Oui, car les modalités de calcul des droits varient selon le régime. En micro-entreprise, vos cotisations retraite sont calculées sur le chiffre d’affaires, avec un minimum requis pour valider des trimestres. En régime réel (EI classique), les cotisations sont proportionnelles au bénéfice, ce qui peut ouvrir plus de droits si vous avez des revenus faibles, mais réguliers. La stratégie peut donc différer selon votre âge ou vos objectifs à long terme.