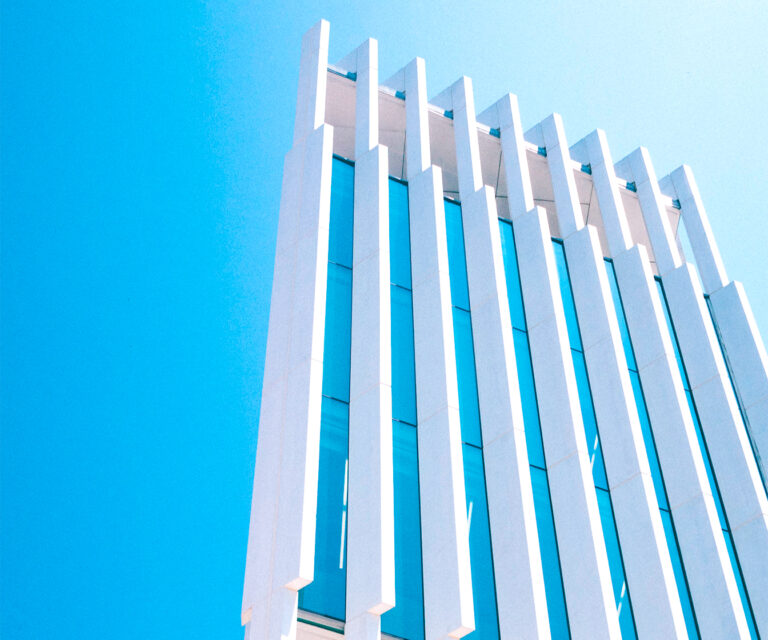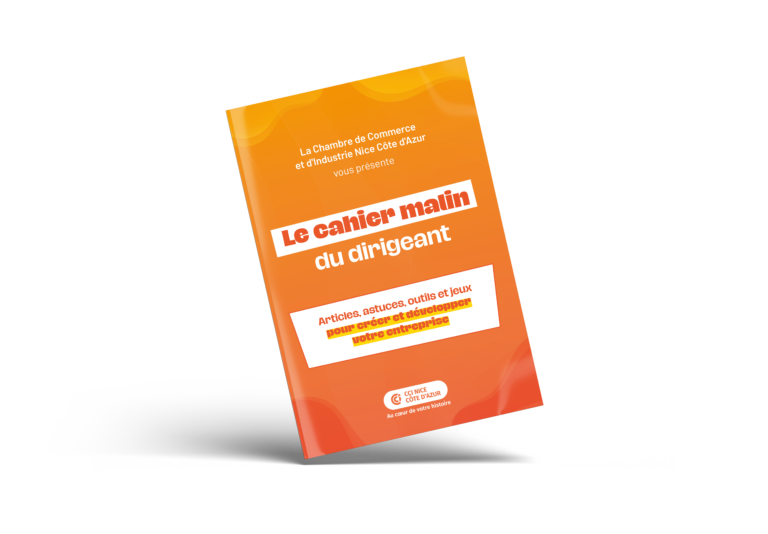L’aspiration à l’indépendance, la volonté de donner du sens à son activité et le besoin croissant d’autonomie poussent de nombreux salariés à envisager la création d’entreprise.
Mais face à la prise de risque qu’implique une rupture conventionnelle ou une démission pure et simple, le congé pour création d’entreprise apparaît comme une alternative stratégique. Encore peu connu, ce dispositif encadré par le Code du travail permet à un salarié de suspendre temporairement son contrat pour lancer un projet entrepreneurial tout en préservant un filet de sécurité professionnel.
Ce congé offre une fenêtre de test pour évaluer la viabilité d’une activité, structurer une offre, rencontrer des partenaires, et ajuster son modèle économique, sans avoir à brûler les ponts avec son employeur.
Le récap’ :
| Éléments clés | Détails |
| Durée du congé | Jusqu’à 1 an, renouvelable 1 fois, soit 2 ans maximum |
| Conditions d’éligibilité | 24 mois d’ancienneté, contrat CDI, projet sans concurrence directe |
| Procédure de demande | Lettre recommandée ou remise en main propre, 2 mois avant le départ |
| Réponse de l’employeur | Délai de 30 jours, refus motivé, silence = acceptation tacite |
| Retour possible | Réintégration, rupture conventionnelle ou démission |
| Avantages principaux | Test du projet sans rupture de contrat, filet de sécurité juridique |
| Freins | Congé non rémunéré, risques de refus, dépendance au contexte interne |
| Rôle de la CCI | Ateliers, accompagnement, diagnostics, rendez-vous individuel |
Un cadre légal précis au service de la transition professionnelle
Le congé pour création ou reprise d’entreprise est défini par les articles L3142-105 et suivants du Code du travail. Il permet à un salarié de quitter temporairement son poste afin de créer ou de reprendre une entreprise, ou encore de participer à la direction d’une Jeune Entreprise Innovante (JEI).
Durant cette période, le contrat de travail est suspendu, mais non rompu : l’employé ne perçoit pas de rémunération, mais conserve son ancienneté, sa protection sociale, et son droit à réintégrer l’entreprise à l’issue du congé. Ce mécanisme s’apparente donc à une parenthèse professionnelle protégée, particulièrement précieuse pour tester un projet sans tout risquer.
Le salarié a également la possibilité de demander un passage à temps partiel au lieu d’une suspension complète, pour garder un pied dans l’entreprise tout en consacrant du temps à son activité entrepreneuriale. Ce format hybride est parfois mieux adapté à des projets qui se développent de façon progressive ou nécessitent des ajustements.
Ce n’est pas une parenthèse vide : c’est une période active au service d’un projet d’avenir.
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Les critères d’éligibilité côté salarié
Tous les salariés ne peuvent pas prétendre à ce congé. Il faut remplir des conditions précises :
- Ancienneté : Le salarié doit justifier d’au moins 24 mois de présence, consécutifs ou non, dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Cette règle vise à réserver le dispositif à des collaborateurs ayant une certaine stabilité dans leur parcours.
- Type de contrat : Le congé est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée (CDI). Des exceptions existent pour certains salariés en CDD si la convention collective applicable le prévoit explicitement.
- Projet non concurrent : Le projet de création ou de reprise d’entreprise ne doit pas entrer en concurrence directe avec l’activité de l’employeur actuel, afin d’éviter tout conflit d’intérêt.
Des limites liées à la situation de l’entreprise
L’entreprise elle-même doit être en mesure d’accepter une telle absence. Si elle fait face à des difficultés économiques, est en restructuration, ou si des accords d’entreprise limitent ce type de congé, l’accès au dispositif peut être compromis.
Autre règle essentielle : le salarié ne doit pas avoir déjà bénéficié d’un congé pour création d’entreprise ou d’un passage à temps partiel pour le même motif dans les trois années précédentes. Cette restriction vise à éviter des utilisations répétées ou abusives du dispositif.
Durée et modalités du congé : un cadre souple, mais limité
La durée initiale du congé est de 12 mois maximum. Le salarié peut ensuite demander un renouvellement pour une durée équivalente, dans la limite totale de 24 mois. Cette extension doit faire l’objet d’une demande formelle, dans les mêmes conditions que la première.
En parallèle, le salarié peut opter pour une version temps partiel du congé : il conserve une activité réduite dans l’entreprise et consacre le reste de son temps à son projet. Ce compromis, plus sécurisant financièrement, séduit de plus en plus de porteurs de projets.
Deux ans pour transformer une idée en projet viable : c’est un luxe que peu de dispositifs offrent.
Procédure : un formalisme à respecter scrupuleusement
Démarches à suivre
Le salarié doit faire sa demande par écrit, soit :
- Par lettre recommandée avec accusé de réception
- Ou remise en main propre contre décharge
Cette demande doit être transmise à l’employeur au moins deux mois avant la date de début souhaitée du congé.
Contenu obligatoire de la demande
Le courrier doit contenir plusieurs informations précises :
- La date de départ souhaitée
- La durée du congé envisagée
- Une description de l’activité de l’entreprise à créer ou reprendre
- Le type de congé demandé (temps complet ou temps partiel
L’employeur peut-il refuser le congé ?
Le principe de base est que le salarié a le droit de demander ce congé, mais l’employeur peut s’y opposer dans certains cas bien précis. Parmi les motifs légitimes :
- Le départ du salarié porte préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise
- Le nombre de salariés déjà absents pour des motifs similaires dépasse un certain seuil
Dans les PME, cette seconde condition est souvent la plus invoquée, notamment quand les ressources humaines sont limitées.
L’employeur dispose de 30 jours pour notifier sa réponse. Celle-ci doit être motivée par écrit en cas de refus. Si l’employeur ne répond pas dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée par défaut, en vertu de l’article L3142-112 du Code du travail.
Après le congé : quelles options pour le salarié ?
À l’issue du congé, trois issues principales sont possibles :
- Retour dans l’entreprise à un poste identique ou équivalent, avec un salaire équivalent
- Rupture conventionnelle si les deux parties souhaitent mettre fin au contrat à l’amiable
- Démission, si le salarié souhaite poursuivre son aventure entrepreneuriale
Dans tous les cas, le salarié doit informer son employeur de sa décision au moins 3 mois avant la fin du congé.
| 💡 À noter : une clause de non-concurrence, prévue dans le contrat initial, peut continuer de s’appliquer. Il est donc recommandé de relire attentivement son contrat de travail avant toute décision. |
Avantages et limites du congé pour création d’entreprise
Un dispositif protecteur… à condition de l’anticiper financièrement.
| ✅ Avantages | ❌ Limites |
| Sécurité juridique et retour garanti | Aucune rémunération pendant le congé |
| Opportunité de tester un projet à moindre risque | Nécessite un financement de substitution (épargne, aides, etc.) |
| Cadre légal clair et protecteur | Acceptation dépend du bon vouloir de l’employeur |
| Possibilité de moduler le format (temps partiel) | Une seule utilisation tous les trois ans |
Le récap : ce qu’il faut retenir
✔️Le congé pour création ou reprise d’entreprise permet aux salariés de lancer un projet entrepreneurial sans rompre leur contrat.
✔️Il est accessible sous conditions d’ancienneté, de contrat, et de non-concurrence.
✔️La demande doit être formalisée, avec un préavis de 2 mois et un contenu précis.
✔️L’employeur peut refuser, mais uniquement dans des cas définis par la loi.
✔️Le salarié peut revenir, quitter l’entreprise ou négocier une sortie à la fin du congé.
✔️C’est une solution sécurisante, mais qui suppose une bonne organisation financière.
Les solutions de la CCI Nice Côte d’Azur
- Structurer votre projet avec des experts
Ateliers collectifs, sessions de formation, diagnostics entrepreneuriaux : la CCI vous aide à clarifier votre idée, définir votre offre, et choisir le bon statut juridique.
👉 Créer ou reprendre une entreprise – CCI - Envisager la micro-entreprise ?
La solution Micro-entreprise de la CCI vous accompagne dans toutes les étapes : immatriculation, gestion, obligations fiscales, régime social…
👉 Solution Micro-entreprise – CCI
FAQ : Congé pour création d’entreprise
Le salarié peut-il percevoir une aide financière pendant son congé ?
Oui, mais pas de la part de l’employeur. Le congé pour création d’entreprise n’est pas rémunéré par l’entreprise d’origine. Toutefois, certains salariés peuvent mobiliser des dispositifs publics d’accompagnement financier, sous conditions :
- L’ARCE (Aide à la reprise ou à la création d’entreprise), si le salarié a ouvert des droits à l’assurance chômage auparavant (par exemple après une rupture conventionnelle juste avant le congé).
- L’ACRE (Aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise), qui permet une exonération partielle de cotisations sociales la première année.
- Des prêts d’honneur, subventions régionales, ou des concours à la création peuvent également compléter les ressources pendant la période de congé.
Peut-on cumuler le congé avec d’autres dispositifs comme un CPF ou une formation ?
Absolument. Le congé pour création d’entreprise peut être articulé avec d’autres dispositifs, notamment pour renforcer les compétences nécessaires à la réussite du projet :
- Le salarié peut mobiliser son Compte Personnel de Formation (CPF) pour suivre une formation (par exemple en comptabilité, marketing, création d’entreprise).
- Il est possible de demander un congé de formation professionnelle (CFP) en complément, mais pas en simultané.
- Certaines régions ou la CCI peuvent proposer des parcours intégrés de formation durant le congé.
L’objectif : professionnaliser sa démarche entrepreneuriale pour maximiser ses chances de succès.
Ce congé est-il ouvert dans tous les secteurs d’activité ?
En théorie, oui. Le droit au congé pour création d’entreprise est prévu par le Code du travail, ce qui le rend applicable à tous les secteurs privés, sauf exceptions spécifiques prévues par des conventions collectives.
Dans certains domaines, comme la banque, la santé privée, ou l’industrie aéronautique, des accords d’entreprise peuvent prévoir des conditions plus strictes, ou encadrer plus finement les modalités de refus et de retour.
Il est donc vivement recommandé de vérifier sa convention collective et, le cas échéant, de consulter son service RH ou un représentant du personnel.
Que se passe-t-il en cas d’abandon du projet en cours de congé ?
Le salarié peut décider d’interrompre son congé avant son terme. Il doit alors en informer son employeur par écrit, généralement en respectant un préavis d’un mois (sauf accord spécifique).
Deux options sont alors possibles :
- Réintégrer son poste si celui-ci est encore disponible, ou un emploi équivalent.
- Demander un aménagement de son retour (temps partiel, télétravail, changement de service), qui devra être validé par l’employeur.
Attention : l’employeur peut refuser un retour anticipé, notamment s’il a recruté un remplaçant ou réorganisé le service. Il n’a toutefois aucune obligation de licencier le salarié.
Que devient le contrat de travail pendant le congé ?
Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu, ce qui signifie :
- Pas de rémunération
- Pas de congés payés accumulés
- Pas de progression d’ancienneté, sauf dispositions conventionnelles plus favorables
En revanche, les droits acquis avant le congé sont conservés :
- Le salarié garde sa mutuelle d’entreprise s’il y a maintien des garanties collectives.
- Il continue de bénéficier des droits sociaux liés à son statut antérieur.
Le congé pour création d’entreprise est-il compatible avec un congé parental ou un congé sabbatique ?
Non. Ces trois types de congés sont incompatibles sur la même période. Un salarié ne peut pas être simultanément en congé parental, en congé sabbatique et en congé pour création d’entreprise.
Cependant, il est possible de chaîner ces dispositifs si la chronologie le permet. Exemple : un salarié peut terminer un congé parental, puis demander un congé pour création d’entreprise. Chaque congé obéit à ses propres règles et préavis.
Peut-on transformer un congé pour création en rupture conventionnelle ?
Oui, mais avec l’accord des deux parties. En cours de congé, si le salarié souhaite ne pas revenir et que l’entreprise est d’accord, une rupture conventionnelle peut être signée. Celle-ci ouvre droit à :
- Une indemnité spécifique
- Des allocations chômage, si les conditions sont remplies
Ce scénario est fréquent lorsque le projet entrepreneurial prend son envol plus vite que prévu. Il permet un départ serein et encadré.
Ce congé est-il pris en compte pour la retraite ?
Le temps passé en congé n’est pas pris en compte automatiquement dans le calcul des droits à la retraite, puisque le salarié ne cotise pas à l’assurance vieillesse via son employeur pendant cette période.
Cependant, s’il perçoit des revenus via son entreprise, il cotise alors via son nouveau statut (micro-entrepreneur, dirigeant, etc.), ce qui peut compenser cette période. En clair : les trimestres peuvent être validés autrement, mais il faut anticiper.